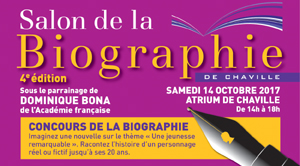 La jeunesse ! Les vingt premières années de sa vie ! Quel beau programme, n’est-ce pas ? Il paraît que ce sont les plus belles années de la vie. Les années d’insouciance, d’irresponsabilité pénale, ou presque. On vous pardonne tout facilement quand vous êtes jeune. « Vous avez la vie devant vous ! », « Il ne faut pas la gâcher avec des bêtises ! » On ne vous juge pas, ou si peu. Vous êtes innocent par essence.
La jeunesse ! Les vingt premières années de sa vie ! Quel beau programme, n’est-ce pas ? Il paraît que ce sont les plus belles années de la vie. Les années d’insouciance, d’irresponsabilité pénale, ou presque. On vous pardonne tout facilement quand vous êtes jeune. « Vous avez la vie devant vous ! », « Il ne faut pas la gâcher avec des bêtises ! » On ne vous juge pas, ou si peu. Vous êtes innocent par essence.
Eh bien moi, je n’ai pas eu la joie de bénéficier de ce privilège. Presque immédiatement, j’ai été sur la sellette. Pourquoi ? Je ne le sus pas tout de suite, mais quelques années plus tard. Quelques années trop tard.
Les premières années, celles d’avant la scolarité obligatoire, celles d’enfant unique, furent comme une parenthèse enchantée comparativement au maelström qui allait s’ensuivre.
Nous vivions dans le cinquième arrondissement avec mes parents, dans un petit studio face à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, où mon père travaillait. Evidemment, je ne m’en souviens pas, ou si peu. En revanche, ce dont je me souviens assez bien, ce sont ces après-midi passés au Jardin des Plantes avec ma mère au bac à sable, avec mes petites majorettes. Eh oui, en ce temps-là, le début des années soixante-dix, le civisme hygiénique était de mise. Les chiens ne déféquaient pas n’importe où. J’apprenais avec elle les différentes variétés de fleurs, les différentes essences d’arbres. Il y avait même des animaux exotiques à la ménagerie ! Quand je repense à ces années bénies, j’ai l’image prégnante de ces allées majestueuses de marronniers pluriséculaires, qui vous font une ombre bienveillante les journées d’été ensoleillées, et qui débouchent sur l’imposant Muséum d’Histoire Naturelle. Vision de ce mammouth d’airain qui trône à l’entrée de la rue Buffon, que je trouvais immense, colossale alors, et qui depuis, me semble si modeste.
Quel bel arrondissement ! La Sorbonne, le Panthéon, l’ENS, l’Ecole Polytechnique, la Mutualité, la Mosquée de Paris, et nous, et moi. Que faisions-nous là ? Nous, les immigrés algériens. Alors, on a transhumé vers des cieux plus conformes à notre espèce. Saint-Denis. Saint-Denis et sa basilique, nécropole des rois de France. Mais nous, ce fut plutôt le cosmopolitisme et l’insalubrité du quartier de la gare. Ses bouges et sa faune interlope. Mon père nous avait reclus dans le plus immonde taudis du coin. A l’extrémité du canal de la Seine. Mais il y avait deux pièces, une cuisine, et il y avait même aménagé une salle de bain. Et surtout, surtout, il était propriétaire ! Peu lui en soucia que les murs suintèrent d’humidité, ou que la lumière n’entra que par une petite lucarne dans ces modestes pièces en enfilade. C’est ici que débutèrent mes allergies tenaces. Enfin.
Je poursuivais mon éducation à l’école maternelle Suger. Un fameux dionysien. Mes deux premières années furent parfaitement heureuses. Mes maîtresses étaient les plus gentilles et les plus jolies du monde, après ma mère bien sûr. Je chantais tout le répertoire enfantin avec un élan jubilatoire sans retenues. J’aimais chanter. J’aime toujours chanter. Mais je suis moins juste, voilà tout.
J’adorais la pyrogravure aussi. Cela me semblait tellement magique.
J’apprenais également l’alphabet, les couleurs, et à compter avec ma mère, devant un entrepôt de camions multicolores, devant lequel nous passions lorsqu’elle m’accompagnait à l’école, avant de se rendre à son travail, à Paris, dans le Marais. Elle était couturière. J’ai toujours vu ma mère coudre. Et bien coudre. C’est peut-être son don le plus reconnu, après celui d’aimer son prochain sans exclusives. Je ne connais personne d’aussi conciliant avec la condition humaine, même la plus crasse. Je crois que j’en ai reçu un peu l’héritage. Et ce n’est pas une bonne chose, croyez-moi. Que de déboires m’aurai-je épargné si seulement j’avais été un peu plus égoïste, un peu plus jaloux, un peu plus médisant, un peu plus hypocrite, un peu plus cynique. Mais je parle, je parle, vous le savez aussi bien que moi. Il n’y a qu’à s’asseoir et observer le spectacle de nos contemporains, n’est-ce pas ? C’est ce que je fais désormais, avec un coca bien frais, pour aider ma digestion capricieuse, les jours de campagnes électorales.
Là où j’aurais dû me méfier, c’est à la dernière année de maternelle. Une maîtresse corse. En tous points conforme aux clichés. Mauvaise elle était. Toujours à chouchouter son petit fils chéri, sans égards et sans mesures pour le reste des enfants.
Et puis tout s’est subitement assombri à mon entrée en primaire, à « l’école des garçons » Jules Guesde. Bien entendu, elle était mixte. C’était simplement un reliquat de la IIIème République qui était gravé au fronton de l’édifice qui s’offrait à nos yeux encore innocents. J’aurais dû me douter qu’avec un tel tuteur spirituel cela dégénérerai. Ah oui, j’ai oublié de vous dire. Dès que j’ai appris à lire. Et j’ai appris très tôt et très vite, je dévorais le dictionnaire Larousse de ma mère, et je me mis à fréquenter assidûment la bibliothèque municipale. Donc, je savais qui était Jules Guesde, et Jules Vallès, le nom de l’école primaire attenante, et une chose en amenant une autre, Louise Michel, Proudhon, Robespierre, Danton, Saint-Just, Napoléon, Georges Séguy, Georges Marchais, et François Mitterrand. Des noms qui écorchaient les oreilles d’une certaine bourgeoisie, mais très tôt, j’ai eu une « conscience de classe », en tout cas la conscience de ma classe, et ils devinrent ainsi naturellement mes héros.
Je sais qu’on me reprochera la présence de Napoléon dans cette galerie de personnalités « ouvriéristes », mais n’avait-il pas sauvé l’idéal républicain, vidé de sa substance par le Directoire ? Révisez la période du Consulat, et interrogez-vous. Prend-t-on sa retraite à trente-cinq ans ?
Et ce fut ma première maîtresse de primaire qui me fis goûter de la trique pour la première fois. Comme j’étais un enfant « turbulent », on dirait aujourd’hui « hyperactif », j’étais régulièrement puni. Ce fut d’abord le piquet, pendant des heures à regarder debout le coin du mur, les mains sur la tête, parfois sur une jambe, et puis ce fut quelques gifles au passage, c’était l’époque qui voulait ça sans doute. Et puis vinrent les « zéros de conduite », qui ne furent pas atténués par les « A » ou les dix sur dix en « travail » dans l’esprit de mon père. Et surtout, ce contraste ne souleva aucune interrogation de sa part. Les coups se mirent à pleuvoir, à la maison, sur mon corps « chétif », de son propre aveu. D’abord la ceinture. Et puis, certainement que la sanction lui sembla trop douce, il passa à la boucle. Et là, effectivement, j’avais mal. J’avais très mal. J’avais l’impression de tutoyer la mort à chaque meurtrissure de ma chaire. Je pleurais à chaudes larmes, mais ni mes plaintes de douleurs, ni l’intersession de ma mère ne le distrayaient de sa démarche punitive, qu’il pensait éducative je suppose. C’est la fatigue qui mettait un terme aux séances, d’où il sortait rougeoyant et suintant, essoufflé, certainement satisfait de sa juste besogne de père et de chef de famille tout puissant.
Et comme si cela ne suffisait pas, à la fin du cour préparatoire, une nouvelle directrice prit ses fonctions. Une corse. Je soupçonnais à peine mon malheur à venir. Je fus vite initié aux méthodes de la dame. Ce qu’elle n’aimait pas chez moi, elle, c’était mon sourire. Ce sourire permanent que j’arborais en toutes circonstances. Elle pensait que c’était « ironique », que je me moquais d’elle. Alors, j’eus droit à ses « sandwichs ». Des paires de gifles assénées simultanément sur les deux joues, par dix, toujours. Ce devait être son chiffre fétiche à cette républicaine socialiste. Elle poussa même la perversité à faire effectuer ce décompte sinistre à voix haute par ses élèves, hilares. Je n’ai jamais pleuré devant elle, ou esquissé le moindre geste d’évitement. Je mettais un point d’honneur à endurer l’épreuve, mon regard amande planté dans le sien, noir.
Mon maître préretraité de CM1, lui, c’était la fessée déculottée devant toute la classe son truc. Et il n’y allait pas de main morte le bougre. J’étais son souffre-douleur désigné. N’avais-je pas été précédé par ma « réputation » ? J’étais le seul à bénéficier de ce privilège, et pourtant il y avait de sacrés loustics dans ma classe. Et n’allez surtout pas penser que j’avais les mêmes goûts peu conventionnels que Rousseau, mais je crois que je n’ai jamais pleuré en public, ou si peu. Il aimait aussi me tirer les oreilles. J’avais l’impression qu’elles étaient prêtes à se décoller à chacun de ses assauts, malgré mes étirements sur les pointes des pieds avec une souplesse qu’un danseur classique n’eut pas renié.
Ainsi, tel fut mon lot durant toute la primaire.
Sauf, la dernière année, en CM2. C’était l’ultime année d’exercice de mon nouveau maître. Et, enfin, je me mis à goûter à la vie d’un enfant « normal ». Nulles réprimandes, nuls coups de ceinture, nulles gifles. Elle est passé trop vite cette année, comme toujours tout ce qui m’arrive de bien.
Seule ombre au tableau, je me mis à chaparder, parfois dans les magasins, plus souvent dans le porte-monnaie de ma mère. Pourtant, il m’aurait suffit de le lui demander. D’ailleurs, quand j’apportais à la maison le fruit de mes forfaits, elle ne disait mot. Je crois qu’inconsciemment, comme dirait je suppose un bon psy de télévision, j’espérais une réaction de sa part, « pour mettre tout à plat », en vain. Elle était murée dans son silence. Elle préférera toujours faire l’autruche. Mais je ne lui en ai jamais vraiment voulu. C’était une femme fragile émotionnellement, sous l’emprise d’un pervers narcissique, mon père. Et moi, j’attendais mes dix-huit ans avec impatience. Pas pour le bachot, je n’ai jamais envisagé ma vie durant avoir d’autre ambition que celle d’écrire, mais plutôt pour me libérer de l’emprise de ce père à demi fou.
Au collège, business as usual, les « avertissements de conduite » succédèrent aux « zéros de conduite ». Seul fait notable, j’étais devenu un « boutonneux ». Mon acné juvénile me ravageait le visage, m’interdisant toute tentative séductrice envers mes camarades féminines, qui pour un certain nombre d’entre elles commençaient à être formées, m’éveillant un peu plus, s’il en avait été besoin, à la rêverie sentimentale. Cependant, le veto de mon père, en ce qui concerne le commerce avec le beau sexe, était à lui seul dissuasif. Il quadrillait Saint-Denis pour ainsi dire de son réseaux de compagnons de prière de la mosquée. Rien ne lui échappait. Et n’allez pas penser que j’eus un répit du côté des châtiments corporels. Aux sanctions physiques s’ajoutèrent les humiliations quotidiennes et les insultes. « Abruti », c’était sa préférée. Aussi, pour ne pas paraître complètement niais, je m’évertuais à jouer un nouveau rôle. Une espèce de marginal, suffisamment voyou pour ne pas être importuné par les vannes des autres élèves, et suffisamment solitaire pour ne pas avoir à partager trop de confidences. Je passais pour être « méchant », alors je me suis construit un rôle en conformité avec l’opinion commune.
Et je dois dire qu’un jour il s’est surpassé dans la violence. Mon avancée en âge ne le dissuadait pas. Après un énième avertissement de conduite, il ne travaillait pas ce jour là, il décida de m’accompagner au collège. Tout le long du chemin il vociféra sur moi. Vous imaginez ma gêne. Déjà que venir accompagné par son père, « c’est la honte », mais en plus, un père dans cet état. Les élèves qui étaient attroupés devant la grille, encore close, étaient terrorisés face à ce spectacle inédit. Croyant faire une diversion, je décidai d’entrer dans l’établissement en passant par le parking des profs, ouvert. Je me figeai en regard du pilier dévolu à ma classe, la 5ème H. Et là, toujours à ses vociférations, il me décocha une brusque série de coups de poing. Il avait été boxeur. Une de ses fiertés. Je tombai. Il continua, à coups de pieds. Je n’avais pas mal. J’étais seulement honteux du spectacle qu’offrait mon père aux autres élèves, dont je sentais les regards éberlués, massés, les visages s’écrasant contre les barreaux rouillés. Il fallu l’intervention d’un pion courageux pour me soustraire à cette bête en furie. Il l’avait ceinturé énergiquement, et m’avait entraîné en salle de permanence. Je devinais la principale et son adjoint siroter tranquillement leur café matinale à travers les rideaux translucides du bureau de ce dernier, satisfaits. « J’avais reçu une bonne leçon. »
A la fin de la 4ème, j’étais renvoyé. C’était écrit.
Le premier trimestre de la 3ème, je le passais chez moi. Je trompais l’ennui en lisant quelques romans et en reproduisant les schémas des organes du corps humain. Les fêtes de fin d’année étaient passées et je n’étais toujours pas inscrit dans un quelconque collège. J’avais quatorze ans, et je m’étonnais de l’inertie des services publics. La scolarité n’était-elle pas obligatoire jusqu’à seize ans ?
En janvier, idée lumineuse de mon père ! Il m’expédia à Rabat, au Maroc, dans la famille d’un prétendu commissaire de police, avec lequel il avait sympathisé en faisant l’admission de sa fille à l’hôpital. Heureusement que j’avais pris avec moi un peu d’argent de poche, que j’échangeai en monnaie locale à l’aéroport. Personne ne m’attendait. Je tendis fébrilement l’adresse griffonnée sur un bout de papier à un taxi. Au bout d’une petite demi heure, j’étais face à ma « famille d’accueil » et leur villa. Une bâtisse encore en construction, que je découvrirai sans eau chaude, sans chauffage et sans électricité. Même si les hivers sont doux en Afrique du Nord, l’adaptation fut rude. Je fis mon inscription scolaire au collège français du coin, accompagné par l’une des filles de mes bienfaiteurs. Je devins immédiatement la « mascotte » de ma classe, nimbé de mon aura parisienne. Pour le prof de français particulièrement, un indien de Pondichéry, mon accent de titi était une véritable attraction, dont il s’évertuait à goûter la sonorité en m’interrogeant sans cesse.
Mais, ce fut pour moi, également, l’occasion de faire connaissance avec ce détestable esprit colonial français dont certains profs semblaient jouir complaisamment, ignorants de la marche du siècle. Il me sembla être immergé dans l’un de ces vieux films américains dépeignant le sud profond avec son étiquette désuète. Inévitablement, j’eus maille à partir avec un prof d’EPS raciste, qui me pris pour un rejeton de la bourgeoisie locale. Manque de bol, j’étais aussi français que lui. Mais cette altercation fournit le prétexte à mon principal pour alerter mon père sur mon incurie notoire, dont j’étais seul ignorant.
De retour à Saint-Denis, et devant affronter la colère homérique de ma mère, mon père m’inscrivit en catastrophe dans un collège privé de Drancy. Mes lacunes étaient criantes. J’entrais bon dernier, je finissais premier, couronnant un trimestre d’efforts inédits. Le passage en classe de seconde était assuré.
Et, en ce début d’année scolaire 1985/ 1986, je pensais, benoîtement, que tout était rentré dans l’ordre au lycée Paul Eluard de Saint-Denis. Que nenni, saisi par un nouveau spasme de sa folie dévastatrice, mon père nous expédia, ma mère, mes petites sœurs, et moi, à Oran, en plein milieu du trimestre, avec armes et bagages !
Je suis revenu l’année suivante, seul. J’ai été encore renvoyé, mais Madjer avait gagné la coupe des clubs champions. Je me suis remis à voler un peu, des CD essentiellement, pour me faire de l’argent de poche. Je roulais à pleine vitesse à travers le 93 sur mon scooter volé, avec un parasite social accroché à l’arrière de ma selle. Ma mère est revenu avec mes sœurs, et moi je suis parti pour Alger pour pouvoir passer le bac dans un lycée algérien francophone. Classe de terminale scientifique où échoua la crème des rejetons de la nomenklatura. Des filles et des fils de généraux, de médecins, de juges, d’entrepreneurs, et moi, fils d’ouvrier, qu’est-ce que je faisais là ? Mais, comme au Maroc, mon aura parisienne agissait quasi-magnétiquement sur ses esprits matérialistes. Bien entendu, j’ai raté le bac. Ma belle motivation c’était évanouie dans les brumes de la casbah. Je suis revenu à Saint-Denis. Ma famille repartait à Alger d.ans un chassé-croisé devenu, désormais, rituel. Et surtout, surtout, j’avais dix-huit ans.
Je m’appelle Henry Choiseul. Je suis né entre 1968 et 1970. Et je vous aime.
« Chacun pleure à sa façon le temps qui passe. »
Louis-Ferdinand Céline
Voyage au bout de la nuit
